
Pages
Le mât Fénoux
Découvrez le mât Fénoux, classé monument historique et situé à l'entrée du Goyen.

Découvrez des grandes figures de l'histoire d'Audierne.

1763-1839
L'un des députés finistériens élu à la Convention en 1792, promoteur d’un enseignement public gratuit à Audierne.
Mathieu Claude Guezno est né en 1763 à Audierne dans une famille bourgeoise de négociants et de maîtres de barques. Il fait ses études au collège de Quimper, alors l’un des plus réputés de Bretagne, dont les enseignants sont des religieux favorables, dans leur immense majorité, aux idées des Lumières. En 1790, il est élu au Directoire du Département du Finistère, puis, le 7 septembre 1792, à la Convention. Il rejoint alors Paris et votera, comme la majorité des Conventionnels, la mort de louis XVI en janvier 1793. Il est chargé dans les mois qui suivent de la réorganisation de la Marine, en particulier à l’arsenal de Rochefort. De retour à Paris en 1794, il est désigné parmi les Constitutionnels pour participer, aux côtés de Hoche, aux luttes et aux négociations avec la chouannerie du fait de sa pratique du breton depuis son enfance. Les archives qu’il constituent durant l’année 1795 constituent l’une des rares documentations sur les discussions entre la Convention et les responsables Chouans à présenter une autre source que celles établies par ces derniers.
En octobre 1795, sous le Directoire, il est élu dans l’une des deux composantes législatives mise en place : le Conseil des Cinq-Cents où il siège jusqu’en 1797. En 1798 il rejoint Audierne et y est nommé comme receveur des douanes.
En novembre 1815, après la chute de Napoléon, la Restauration le relève de son poste de receveur des douanes. En janvier 1816, le pouvoir royaliste qui a vu la réforme libérale de la constitution (« l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire » d’avril 1815) engagée par le pouvoir napoléonien après le retour de l’île d’Elbe, comme la reprise d’une politique révolutionnaire, vote le bannissement à vie des anciens Constitutionnels régicides ayant approuvé cette réforme. C’est le cas de Mathieu Guezno qui doit quitter la France en février 1816.
Après les journées de soulèvement populaire de juillet 1830, dites des « Trois glorieuses » qui mettent fin à la Restauration, le retour des exilés est possible et la municipalité d’Audierne écrit à Guezno « …de rentrer, le plus tôt possible, au milieu de ses compatriotes et de revenir y prendre la place qu’il avait longtemps occupée… »
Mathieu Guezno a 67 ans à son retour à Audierne à la fin 1830 et sera demeuré 15 ans en exil, principalement à Bruxelles.
À son arrivée, il retourne à sa maison de la rue Coste Cleden* pour prendre des archives qu’il y avait cachées. Elles constituent une partie des documents concernant la guerre de Vendée précédemment cités. Cette maison ayant été vendue par le notaire qui gérait ses biens durant son exil, il emménage dans une maison de l’actuelle rue Léon Gambetta.**
Auprès du conseil municipal, il impulse alors la création d’un enseignement public par un instituteur appointé par la commune, du moins pour les garçons, les filles n’ayant accès qu’à l’enseignement religieux, et obtient qu’il soit gratuit pour les garçons les plus pauvres.
Sa tombe porte, gravé dans la dalle du monument funéraire, le rappel de ses mandats nationaux à la Convention puis au Conseil des Cinq-Cents. Elle est visible dans le cimetière de Kervreac’h à Audierne.
* Cette maison existe toujours au 24 de l’actuelle rue Guezno. À proximité habita également son frère, Joseph Guezno, qui fut maire d’Audierne.
** Cette maison, remaniée depuis le XIXe siècle, n’a conservé en façade que quelques éléments d’époque.

1781-1872
Militaire et homme politique, ami de Louis-Napoléon Bonaparte.
Né à Quimper en 1781, il entre dans la marine à moins de 20 ans comme quartier-maître au 37e bataillon, et prend rang en 1809 dans l’armée de terre comme lieutenant au 45e de ligne.
Un mois plus tard, lors de la capitulation de Flessingue près d’Anvers, il fait partie des 4 000 militaires français, soldats et officiers, déportés en Grande-Bretagne. Il reste sur les pontons-prisons anglais jusqu’en 1814. Libéré, il est mis en demi-solde par la Restauration, puis affecté à l’état-major en 1819. En 1823, il participe à la guerre d’Espagne comme aide de camp du général Bourke ; le pouvoir royal français permet alors le rétablissement du pouvoir royal absolutiste de Ferdinand VII d’Espagne contre les Cortès et l’armée constitutionnelle.
Chef d’escadron d’état-major en 1831 et retraité comme tel en 1837, il s’engage activement dans la vie politique. Dès la première tentative de coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte à Strasbourg en octobre 1836, il s’efforce de lui gagner des partisans dans l’armée.
En août 1840, également compromis dans la seconde tentative de coup d’État menée à Boulogne sur mer, il est condamné à quinze ans de détention par la Chambre des pairs. Il ne recouvre sa liberté qu’après la Révolution de février 1848 et l’établissement de la Seconde République. Il sert alors avec ardeur la politique du prince-président, est chargé de diverses missions spéciales auprès des généraux et coopère au coup d’État du 2 décembre 1851 qui met en place le Second Empire.
Il devient alors conseiller général du Finistère et l’un des vice-président du Conseil général. « Candidat officiel » des bonapartistes aux élections législatives qui font suite au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, il est élu le 20 février 1852 et devient député au Corps législatif de la 3e circonscription du Finistère, avec 16.870 voix (17,311 votants sur 37,793 inscrits), puis siège dans les rangs de « la majorité dynastique ».
Le 9 juin 1857, l’Empereur Napoléon III le nomme sénateur et le Préfet du Finistère le nomme maire d’Audierne.
Au Sénat, il participe à la préparation de lois sur la grande pêche maritime (1860) et la réforme de l’organisation l’état-major de la marine (1863), puis se fait souvent excuser aux séances du Sénat à partir de 1866, probablement du fait de son état de santé alors qu’il a déjà 85 ans. Il est alors également peu présent au conseil municipal d’Audierne. Il meurt à Paris le 22 août 1872 mais se fait inhumer au cimetière de Kervreac’h, à Audierne, dans la petite chapelle funéraire qu’il y a fait édifier.
Lors de ses mandats sous le Second Empire, il soutient entre autres les travaux d’aménagement du port d’Audierne ainsi que de celui de Brest, dont « le pont impérial » détruit pendant la Seconde Guerre, au-dessus de l’arsenal.

1831-1847
Inventeur d’un système de guidage à distance des navires.
Pendant l’hiver 1831, le lieutenant de vaisseau audiernais Julien Fénoux, en congés dans sa famille, constate combien l’entrée du Goyen est difficile entre ses bancs de sables mobiles pour les navires, tous à voile à l’époque. À cette occasion, il guide depuis la grève un navire en difficulté et conçoit, dans les années suivantes, un système s’inspirant du télégraphe à bras, pour informer les navires sur l’accessibilité des ports et la route à suivre.
Après des essais à Port-Louis, où il est en poste, il crée un « mât-pilote » rapidement agréé par la Marine. Son fonctionnement est publié dans un article des Annales maritimes en 1839. La même année, la chambre de commerce de Lorient vote le principe de créer un mât à Port-Louis et le département du Finistère d’en créer un à Audierne.
En 1841, le ministère des Travaux publics publie une « Instruction pour les navigateurs » explicitant les signaux de son « aile indicatrice, qui apparaît sous la forme d’un triangle isocèle (…) mobile sur son axe » que l’on pointe « du côté où on veut faire gouverner le navire ».
La même année ces instructions sont publiées par la « Société générale internationale des naufrages » qui fournit un plan détaillé du mât avec les mesures de ses divers éléments, soit 13,65 m pour le mât et 4,40 m pour l’aile.
Les positions de la flèche mobile servent ainsi à signaler la possibilité d’entrer au port et guident à distance, en temps réel, les navires qui doivent louvoyer à la voile parmi les obstacles, en leur indiquant les chenaux à utiliser sur babord ou tribord.
Les personnels en charge des mâts sont donc des pilotes qu’il convient de former comme tels. Au cours de l’été 1843, Julien Fénoux forme les pilotes de Port-Louis et Saint-Nazaire, puis ceux d’Audierne en décembre. En 1844, il écrit à propos d’Audierne :
Le 27 octobre, par un grand vent de S.S.O., la mer affreuse, deux petits chasse-marées, chargés pour la Rochelle, qui n’avaient pas pu doubler les Penmark, cherchaient à relâcher à Audierne ; la barre brisait avec trop de fureur pour que les pilotes pussent aller à bord de ces navires, qui ne connaissaient pas l’entrée. Me trouvant seul au mât-pilote, je le manœuvrais moi-même et j’eus le bonheur de les faire entrer l’un après l’autre, dans le port, sans accident : sans ce secours, ils se seraient infailliblement perdus corps et bien…
Dans la seconde partie du XIXe siècle, l’aménagement de l’entrée du port avec un phare et un quai de halage avançant jusqu’à la pointe rocheuse du Raoulic, amène à déplacer le mât-pilote en 1882 à son emplacement actuel, pour l’implanter au plus près de l’embouchure du Goyen.
Le mât-pilote d’Audierne est protégé au titre des Monuments historiques depuis 2022 et a été restauré en 2023 grâce à des dons privés et des subventions. N’ayant plus de fonction d’aide à la navigation depuis le milieu du XXe siècle, sa flèche a été fixée verticalement sur le mât afin de renforcer la structure métallique de celui-ci, mise à rude épreuve lors des tempêtes mais une application interactive permet de découvrir son fonctionnement.
*Audierne 1790 – Lorient 1847 (sa tombe est au cimetière ancien de Kervreac’h à Audierne).
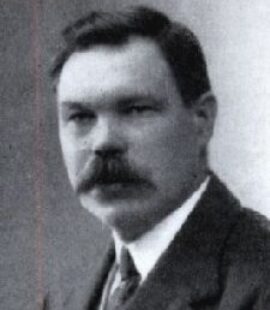
1889-1976
Un élu capiste engagé pour son territoire, la paix et la démocratie, qui fit front à Pétain.
Maire d’Esquibien de 1925 à 1971, député du Finistère de 1932 à 1942**.
Issu d’une famille de cultivateurs, Jean Perrot est élu maire d’Esquibien en 1925 et conseiller général du canton de Pont-Croix en 1927. Il se présente aux élections législatives de 1932 et affirme alors son adhésion à la politique extérieure d’Aristide Briand qui œuvre à une politique de paix en Europe.
Élu député, il s’inscrit au groupe radical et radical-socialiste. Dans la continuité des spécificités de sa commune et de sa circonscription, agricole et maritime, il siège dans les commissions de la marine militaire, de la marine marchande (comme vice-président) et de l’agriculture (comme secrétaire). Il présente des propositions de lois qui s’inscrivent dans des préoccupations économiques, sociales et environnementales de l’époque qui renvoient à certaines problématiques actuelles.
Ainsi, il invite le gouvernement à considérer la crise des ports sardiniers et à étendre aux marins-pêcheurs le bénéfice de la loi sur les assurances sociales. Il dépose des propositions de lois relatives au tarif douanier applicable aux importations de crustacés et d’orge ou visant à faire bénéficier les assurés des retraites ouvrières et paysannes des allocations et bonifications d’État, à réduire les droits sur l’essence à usage agricole… Il est rapporteur des projets de lois sur l’approbation de la convention internationale visant à limiter la chasse à la baleine. En 1935, il invite le gouvernement à réglementer l’importation des engrais azotés et interpelle le gouvernement sur les mesures à prendre pour assurer l’écoulement des conserves de poisson et remédier à la crise de la pêche maritime.
Il est réélu aux législatives d’avril 1936 et signe le « programme du front breton » avec 41 autres candidats, allant du parti communiste aux partis conservateurs (à l’exception du Parti national breton). Cette déclaration prône une démarche de régionalisation et un enseignement progressif du breton dans les écoles publiques de Bretagne. Il dépose à nouveau de nombreuses propositions de lois. Ainsi, il propose l’extension du bénéfice des allocations familiales aux petits exploitants et ouvriers agricoles…
Le 10 juillet 1940, il est l’un des 80 députés et sénateurs présents à Vichy qui refusent de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. En juin 1944, il nommé au Comité départemental de la Libération lors d’une réunion clandestine à Quimper et demeure de manière continue maire d’Esquibien jusqu’en 1971.
* Il est né le 7 juin 1889 à Esquibien et y décède le 22 janvier 1976.
**Le mandat des députés élus en 1936 devait s’achever en 1942, mais l’Assemblée nationale est suspendue par Pétain en juillet 1940 et les nouvelles élections n’ont lieu qu’en 1945.